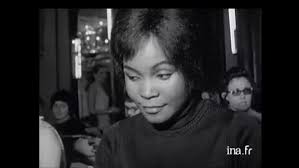19ème tournoi de dactylographie (juin 1969)
Présentation
Reportage d’une durée de 58 secondes, diffusé le 3 juin 1959 dans l’émission Journal de Paris, présentant le 19ème tournoi de dactylographie organisé par le Comité international de perfectionnement dactylographique. Images des candidates et du jury commentées par le journaliste Jean-Claude Sire.
Contextualisation
Au cours des années 1960, la consommation de masse est la locomotive de la demande accrue de main d’œuvre. Cette demande favorise la montée de l’emploi féminin, amorcée au milieu des années 1960. Deux phénomènes majeurs marquent la période : d’une part, la reconversion d’un nombre important de travailleuses indépendantes vers le salariat (en 1946, 41% des femmes travaillaient dans l’artisanat et l’agriculture ; elles ne sont plus que 8,6% en 1975 ; inversement, le pourcentage de salariées dans la population active féminine passe de 59 % en 1954 à 84,1% en 1975) ; d’autre part le déclin du modèle de la femme au foyer (ainsi le nombre de femmes mariées travaillant augmente, atteignant 1/3 de la population active féminine en 1962). Cette demande favorise le développement du salariat féminin principalement dans le secteur des services.
Analyse
Le thème du reportage (un concours de dactylographie) permet d’aborder le processus de tertiarisation de l’économie (lié au développement de l’Etat-Providence et des services marchands généré par une forte demande des personnes et des entreprises). Les concours de dactylographies donnent, comme l’organisation du système scolaire, un modèle déterminé en fonction des destins professionnels probables. Ainsi, si l’école se veut émancipatrice (progression très rapide du nombre de filles scolarisées dans le secondaire), elle est conservatrice dans la mesure où elle crée des filières qui reprennent les divisions du monde social : ainsi la mise en place de séries nombreuses pour le baccalauréat a pour effet de canaliser les filles dans les séries F et G (sciences médico-sociales et techniques administratives, secrétariat) et les garçons dans les séries C et M (mathématiques/sciences physiques et mathématiques et techniques). Le reportage offre la même dichotomie : d’un côté il illustre le discours de la modernité, de la performance et du succès nourri par les missions de productivité envoyées aux Etats-Unis, propose aux femmes des classes moyennes une image jeune, séduisante et émancipée tout en rappelant leur rôle fondamental de mère. Le reportage montre l’affirmation du modèle de la femme qui travaille, modèle encouragé par les responsables de la planification comme réponse au besoin de main d’œuvre : « La candidate ayant tapé le plus de texte possible sans faute se verra remettre un vase de Sèvres offert par le Président de la République par intérim ».
Ressources complémentaires :
Bibliographie
« Rose-Marie Lagrave, Une émancipation sous tutelle » in Georges Duby et Michelle Perrot (dir.) Histoire des femmes, tome 5 Le XXème siècle, Paris, Plon, 1992, pp.431-462.
Sitographie
http://www.ina.fr/video/CAF95053797
Filmographie
Extrait du film Populaire : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19434307&cfilm=197289.html